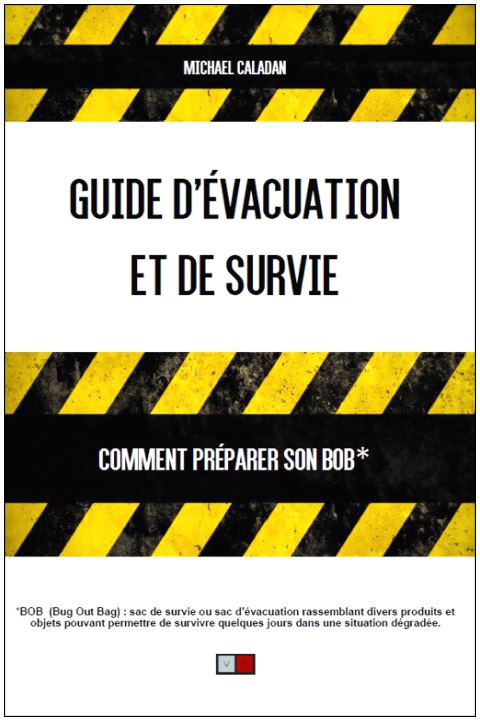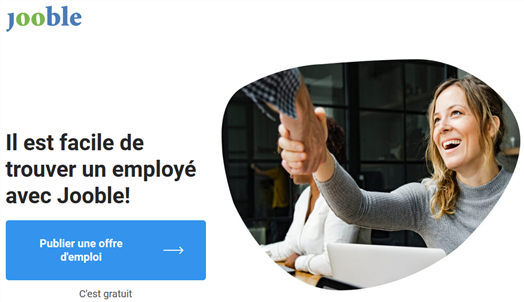De l’école à l’entreprise, l’erreur est stigmatisée. Est-ce un tort ?
Stigmatiser l’erreur est un tort absolu ! L’erreur est, cruellement, considérée comme synonyme de la faute. La faute est une notion morale, qui renvoie au Bien et au Mal, qui s’inscrit dans un cadre formatif culturel et religieux. Elle n’a pas sa place en formation. L’erreur n’a rien d’une faute. Elle est une immense source d’apprentissage. Nous disons dans l’ouvrage « On n’a jamais appris à faire du vélo dans un livre », on pourrait rajouter « …ni sans tomber ». Dans le processus de la maîtrise du vélo, tomber est, clairement, une erreur. Mais c’est aussi nécessaire à l’apprentissage. Il faut encourager l’erreur, la provoquer au maximum, favoriser, aussi, l’autocorrection, c’est-à-dire aider l’apprenant à trouver lui-même des corrections au fur et à mesure de son apprentissage. Car si stigmatiser l’erreur est une erreur pédagogique, apporter une correction toute prête, « couperet », l’est tout autant.
Sachant qu’il faut un responsable pour toute erreur, nos sociétés judiciarisées autorisent-elles encore « le droit à l’erreur » ?
Là encore, il faut la distinguer de la faute. Enfreindre la loi doit être réprimé. Mais essayer quelque chose de bonne foi ne devrait pas l’être. C’est le sens de la réécriture du principe de précaution, trop souvent bloquant, qui commence à se dessiner.
Si « l’expérience est la somme de nos erreurs » pour paraphraser Oscar Wilde, comment apprendre lorsqu’on n’est pas autoriser à se tromper ?
Je me le demande. Par rabâchage, comme pour les tables de multiplications, qui ne servent à rien ? Ou parce qu’on poursuit « la pédagogie de la honte », comme en dictée par exemple, ou un texte juste à 95% reçoit 0/20 ? On ne le répétera jamais assez : il faut encourager l’essai, la prise de risque, l’autocorrection dans l’apprentissage.
La simulation reste une situation fictive. Peut-on tirer de l’expérience d’un exercice de fiction ?
Vous avez raison. La simulation se déroule dans un « cadre de cohérence », qui n’a pas vocation à être réaliste. Il est donc absolument fondamental de « re-caler » ce qui a été décalé, c’est à dire de reboucler, lors du débriefing, les comportements observés lors de la simulation, pour les expliquer, les challenger ensuite.
Simuler, est-ce simplement tester notre faculté à nous tromper ?
Pas uniquement. C’est aussi tester notre faculté à surmonter des contraintes par la créativité et l’adaptabilité, à trouver des solutions en équipe plutôt que seul, à comprendre une nouvelle façon de travailler… Se tromper est un moyen, apprendre est la fin.
Peut-on tout simuler ?
Je le pense. Nous avons déjà simulé avec succès des processus industriels extrêmement complexes, dans des technologies de pointes, ou dans le milieu pharmaceutique par exemple. Nous avons aussi construit des cadres de cohérences complètement décalés, en inventant des conflits intergalactiques, ou en reprenant des passages de l’Histoire. Nous avons notamment transformé en exercice de simulation la crise des missiles de Cuba en 1962, pour la faire jouer à des participants de plusieurs entreprises, et les résultats en matière de travail en équipe, de créativité sous la contrainte, sont absolument fascinants.

Fondateur de Layer cake, le seul cabinet de formation français spécialisé dans la simulation, les serious games, et la gestion de crise, Louis Bernard conçoit et anime des simulations depuis 2001. Convaincu que la mise en situation est la meilleure solution pour l’enseignement comportemental, il a organisé de nombreux modules au sein d’entreprises et auprès d’étudiants en France comme à l’étranger. Il est également chargé d’enseignement à HEC, à l’IRIS et à la Hebrew University of Jerusalem.

 Éditorialistes & Contributeurs
Éditorialistes & Contributeurs Corporate management
Corporate management