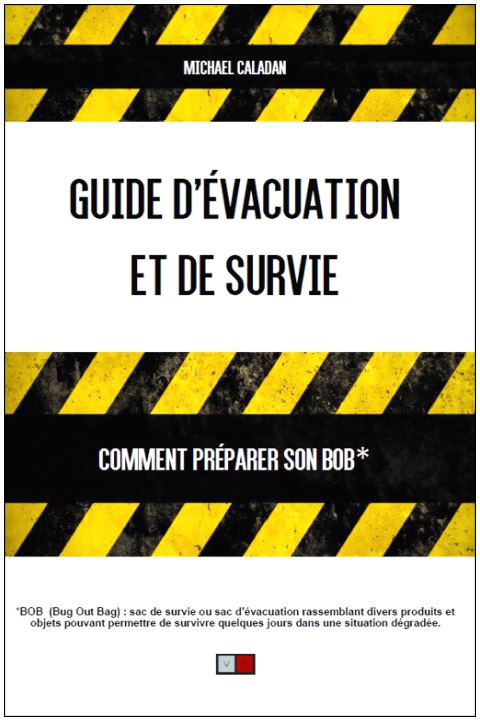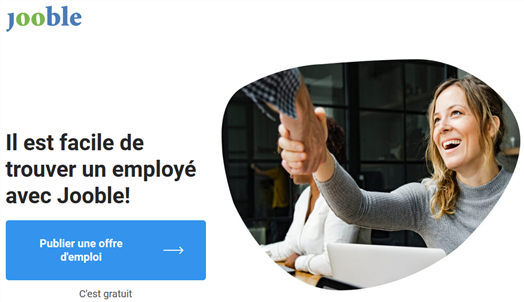Côté européen, la diplomatie française s’adapte assez vite en renversant le paradigme dominant incarné par le soutien inconditionnel au régime de Ben Ali et en accélérant les remaniements au Quai d’Orsay. La diplomatie américaine, elle, n’a pas renoué avec la doctrine réaliste kissingérienne depuis l’arrivée de Barack Obama à la présidence. Elle reste basée sur le principe du « democratic enlargement », mais préconise un retrait de la « hard power » et un abandon de la diplomatie de la canonière, au profit d’une diplomatie publique active où interviennent également les acteurs non-gouvernementaux.
Les facteurs de soulèvement dans le monde arabe étaient présents depuis assez longtemps : échec des stratégies de développement, blocage du développement, confiscation du pouvoir politique et de l’appareil d’État, aggravation des inégalités sociales et captation de la vie politique par les forces politiques au pouvoir.
Ce dernier facteur semble déterminant pour expliquer la stabilité des systèmes politiques. Dans le cas de l’Egypte, les mouvements de contestation parviennent, dès 2002, à gagner la société civile et l’espace investi par les associations de défense de causes (advocacy associations) et les syndicats professionnels, mais les réformes constitutionnelles de 2005 et la main mise sur l’appareil d’Etat garantissent le maintien au pouvoir des alliances patronnées par le Parti National Démocrate (PND). Si 2005 est l’année de l’ouverture, 2010 y est celle de la récupération du pouvoir. Le cas tunisien est différent : un système sans ouverture politique, mais capitalisant la réussite économique et l’élargissement du spectre de la classe moyenne… jusqu’aux lendemains de la crise financière mondiale. La conclusion quasi unanime, avant le 14 janvier 2011, est la suivante : la contestation peut gagner la société civile mais l’Etat est demeuré impénétrable, verrouillé par l’alliance des familles gouvernantes, des bureaucraties et des milieux d’affaires.
Deux inconnues ont bouleversé cette dernière conclusion : la constitution des masses virtuelles à l’aide des nouvelles technologies de communication (facebook, twitter, etc …) compensant l’interdiction des mouvements physiques de masse et la rapidité de l’effet de contagion. Mais cela n’aura pas suffi à expliquer le phénomène révolutionnaire. En arrière plan, une maturation politico-idéologique s’est imposée à travers deux mutations : le dépassement du clivage entre la composante islamiste et la composante moderniste (libérale, marxiste, etc.) de l’opposition et la recherche d’objectifs consensuels, l’instauration d’un nouveau contrat social et le passage de la doctrine de la révolution violente à celle de la désobéissance civile.
Le déroulement du processus révolutionnaire dépend de plusieurs facteurs. Le concept clé est celui de la capacité à atteindre le niveau de la mobilisation intersectorielle. Les révolutions sont dans de nombreux cas parties de la périphérie : Sidi Bouzid en Tunisie, Benghazi en Libye, Deraa en Syrie. La capacité à atteindre la capitale est un élément déterminant, mais demeure difficile d’accès en Libye, problématique dans le cas syrien où les partisans de Bachar el-Assad ripostent par une mobilisation de plusieurs centaines de milliers de personnes dans les rues de Damas, fin mars 2011.
L’un des éléments déterminant l’issue du processus révolutionnaire est la position de l’armée. Dans le cas de la Tunisie, elle se désolidarise du pouvoir contesté et du parti hégémonique. En Egypte, elle donne son Rais en victime expiatoire mais conserve le pouvoir à travers le Conseil supérieur des forces armées. Dans le cas syrien, l’armée constitue le principal rempart de la famille au pouvoir et de la communauté Alaouite. Le cas libyen est intermédiaire : face au ralliement d’un grand nombre d’officiers supérieurs à la révolution, le pouvoir s’appuie sur une dualité militaire armée sous-équipée/garde « présidentielle » surarmée.
Peut-on en déduire qu’il existe une échelle pour classer le degré d’intolérance des dirigeants arabes, ou du moins une typologie distinguant les plus modérés (Moubarak), des cyniques sanguinaires (Assad), des autistes (Kadhafi) ? Ne s’agit-il pas davantage une question de moyens de coercition et de dynamique des rapports de force ?
Les facteurs de soulèvement dans le monde arabe étaient présents depuis assez longtemps : échec des stratégies de développement, blocage du développement, confiscation du pouvoir politique et de l’appareil d’État, aggravation des inégalités sociales et captation de la vie politique par les forces politiques au pouvoir.
Ce dernier facteur semble déterminant pour expliquer la stabilité des systèmes politiques. Dans le cas de l’Egypte, les mouvements de contestation parviennent, dès 2002, à gagner la société civile et l’espace investi par les associations de défense de causes (advocacy associations) et les syndicats professionnels, mais les réformes constitutionnelles de 2005 et la main mise sur l’appareil d’Etat garantissent le maintien au pouvoir des alliances patronnées par le Parti National Démocrate (PND). Si 2005 est l’année de l’ouverture, 2010 y est celle de la récupération du pouvoir. Le cas tunisien est différent : un système sans ouverture politique, mais capitalisant la réussite économique et l’élargissement du spectre de la classe moyenne… jusqu’aux lendemains de la crise financière mondiale. La conclusion quasi unanime, avant le 14 janvier 2011, est la suivante : la contestation peut gagner la société civile mais l’Etat est demeuré impénétrable, verrouillé par l’alliance des familles gouvernantes, des bureaucraties et des milieux d’affaires.
Deux inconnues ont bouleversé cette dernière conclusion : la constitution des masses virtuelles à l’aide des nouvelles technologies de communication (facebook, twitter, etc …) compensant l’interdiction des mouvements physiques de masse et la rapidité de l’effet de contagion. Mais cela n’aura pas suffi à expliquer le phénomène révolutionnaire. En arrière plan, une maturation politico-idéologique s’est imposée à travers deux mutations : le dépassement du clivage entre la composante islamiste et la composante moderniste (libérale, marxiste, etc.) de l’opposition et la recherche d’objectifs consensuels, l’instauration d’un nouveau contrat social et le passage de la doctrine de la révolution violente à celle de la désobéissance civile.
Le déroulement du processus révolutionnaire dépend de plusieurs facteurs. Le concept clé est celui de la capacité à atteindre le niveau de la mobilisation intersectorielle. Les révolutions sont dans de nombreux cas parties de la périphérie : Sidi Bouzid en Tunisie, Benghazi en Libye, Deraa en Syrie. La capacité à atteindre la capitale est un élément déterminant, mais demeure difficile d’accès en Libye, problématique dans le cas syrien où les partisans de Bachar el-Assad ripostent par une mobilisation de plusieurs centaines de milliers de personnes dans les rues de Damas, fin mars 2011.
L’un des éléments déterminant l’issue du processus révolutionnaire est la position de l’armée. Dans le cas de la Tunisie, elle se désolidarise du pouvoir contesté et du parti hégémonique. En Egypte, elle donne son Rais en victime expiatoire mais conserve le pouvoir à travers le Conseil supérieur des forces armées. Dans le cas syrien, l’armée constitue le principal rempart de la famille au pouvoir et de la communauté Alaouite. Le cas libyen est intermédiaire : face au ralliement d’un grand nombre d’officiers supérieurs à la révolution, le pouvoir s’appuie sur une dualité militaire armée sous-équipée/garde « présidentielle » surarmée.
Peut-on en déduire qu’il existe une échelle pour classer le degré d’intolérance des dirigeants arabes, ou du moins une typologie distinguant les plus modérés (Moubarak), des cyniques sanguinaires (Assad), des autistes (Kadhafi) ? Ne s’agit-il pas davantage une question de moyens de coercition et de dynamique des rapports de force ?

Les sociétés politiques arabes post-révolutionnaires ont encore un profil peu identifiable. Un regard superficiel peut porter à privilégier le scénario de la vague islamiste. Or la stratégie politique des Frères musulmans égyptiens (le Parti de la justice et de la liberté) s’est appuyée sur une constante : l’alliance avec les autres familles politiques et la rupture avec les salafites (le Parti Annour). Autre point déterminant : la famille politique majoritaire est élue davantage sur un discours socio-économique et éthique et manie avec prudence les référents religieux, ce qui explique un glissement «plus à droite » de l’électorat des circonscriptions les plus conservatrices. Il en est de même du mouvement Ennahda en Tunisie, dont le pari est de concilier la modernité libérale à la doctrine islamique et de mettre en avant la problématique du développement.
Les partis vainqueurs des élections font face à un soupçon principal : le soupçon de continuité avec l’ancien régime et de réhabilitation de son élite politique. La période de transition relativement longue pose un problème essentiel : celui de la croissance négative de l’économie et de la baisse du rythme des investissements étrangers alors que les hésitations se multiplient en matière de gouvernance économique.
Les zones de crise actuelles sont, sans conteste, la Libye et la Syrie. La gestion de la crise libyenne met en perspective de multiples approches. La fenêtre d’opportunité de l’intervention étrangère dans le conflit libyen est ce bref moment qui sépare les brigades de Kadhafi des principales villes de l’Est : la décision politique d’une intervention coercitive politique puis militaire est prise en temps contraint avec deux piliers initiaux : d’une part, les diplomaties des pays du Golfe, déterminantes au sein de la Ligue des États arabes définissant les grands principes et offrant la légitimité politique, d’autre part, l’axe franco-britannique, capable d’élaborer une intervention dite « post-américaine » qui, dans les faits, s’appuie sur le soutien des États-Unis.
À la sortie de crise, et si l’on excepte l’Émirat du Qatar, deux États se disputent l’ultime légitimité auprès des révolutionnaires libyens : la France et la Turquie.
Deux puissances sont en porte-à –faux : la Russie et la Chine, toutes deux bénéficiaires d’importants contrats sous Kadhafi, écartées par le Conseil national de transition qui affirme ouvertement privilégier les puissances amies.
Dans le même temps, la prévalence de l’argument humanitaire et explique la non-opposition russe et chinoise à la résolution 1973 qui a pour objectif la « protection des civils ». C’est l’application extensive de cette dernière par les forces de l’OTAN et le glissement au « regime change » qui suscite ex post leur hostilité et « justifie» leur double veto concernant la Syrie, en dépit du désastre humanitaire, des exactions des forces de répression du régime et du positionnement des opinions publiques arabes.
Mais, en même temps qu’elle démontre son effectivité, la diplomatie russe perd en légitimité dans l’opinion arabe. L’issue ne saurait être, pour le Kremlin, que de s’ériger en parrain d’un compromis historique capable de mener à une transition démocratique différente dans son processus de ce qu’ont connu les sociétés égyptienne et tunisienne.
En termes de conséquences régionales, les dynamiques actuelles du monde arabe interférent sur l’équation sécuritaire de deux États pivots de la région : l’Arabie et Israël.
L’Arabie agit à contre cycle des révolutions arabes. Elle a accueilli l’ex-président Ben Ali. Elle a critiqué les États-Unis pour avoir abandonné le Maréchal Moubarak ; elle est militairement et diplomatiquement intervenue au Yémen. Enfin, elle a coordonné l’action du Conseil de Coopération du Golfe pour réprimer les manifestations à Bahreïn qu’elle estimait téléguidées par l’Iran pour faire tomber la dynastie sunnite des Al Khalifa dans un pays majoritairement chiite.
Quant à Israël, son environnement stratégique a rarement été aussi préoccupant.
Quelque soit le prochain régime égyptien, il devra prendre ses distances d’avec Israël pour assoir sa légitimité politique intérieure.
En Syrie, les autorités de Tel-Aviv se satisfaisaient d’un dictateur immobile, sur le Golan notamment. L’idéal eut été pour la diplomatie israélienne le maintien d’un « Assad affaibli », c’est-à-dire contraint de casser son soutien au Hezbollah d’Hassan Nasrala au Liban.
Si l’on ajoute l’incertitude stratégique iranienne, on comprendra la sensibilité actuelle de la nouvelle donne sécuritaire pour Israël.
Les partis vainqueurs des élections font face à un soupçon principal : le soupçon de continuité avec l’ancien régime et de réhabilitation de son élite politique. La période de transition relativement longue pose un problème essentiel : celui de la croissance négative de l’économie et de la baisse du rythme des investissements étrangers alors que les hésitations se multiplient en matière de gouvernance économique.
Les zones de crise actuelles sont, sans conteste, la Libye et la Syrie. La gestion de la crise libyenne met en perspective de multiples approches. La fenêtre d’opportunité de l’intervention étrangère dans le conflit libyen est ce bref moment qui sépare les brigades de Kadhafi des principales villes de l’Est : la décision politique d’une intervention coercitive politique puis militaire est prise en temps contraint avec deux piliers initiaux : d’une part, les diplomaties des pays du Golfe, déterminantes au sein de la Ligue des États arabes définissant les grands principes et offrant la légitimité politique, d’autre part, l’axe franco-britannique, capable d’élaborer une intervention dite « post-américaine » qui, dans les faits, s’appuie sur le soutien des États-Unis.
À la sortie de crise, et si l’on excepte l’Émirat du Qatar, deux États se disputent l’ultime légitimité auprès des révolutionnaires libyens : la France et la Turquie.
Deux puissances sont en porte-à –faux : la Russie et la Chine, toutes deux bénéficiaires d’importants contrats sous Kadhafi, écartées par le Conseil national de transition qui affirme ouvertement privilégier les puissances amies.
Dans le même temps, la prévalence de l’argument humanitaire et explique la non-opposition russe et chinoise à la résolution 1973 qui a pour objectif la « protection des civils ». C’est l’application extensive de cette dernière par les forces de l’OTAN et le glissement au « regime change » qui suscite ex post leur hostilité et « justifie» leur double veto concernant la Syrie, en dépit du désastre humanitaire, des exactions des forces de répression du régime et du positionnement des opinions publiques arabes.
Mais, en même temps qu’elle démontre son effectivité, la diplomatie russe perd en légitimité dans l’opinion arabe. L’issue ne saurait être, pour le Kremlin, que de s’ériger en parrain d’un compromis historique capable de mener à une transition démocratique différente dans son processus de ce qu’ont connu les sociétés égyptienne et tunisienne.
En termes de conséquences régionales, les dynamiques actuelles du monde arabe interférent sur l’équation sécuritaire de deux États pivots de la région : l’Arabie et Israël.
L’Arabie agit à contre cycle des révolutions arabes. Elle a accueilli l’ex-président Ben Ali. Elle a critiqué les États-Unis pour avoir abandonné le Maréchal Moubarak ; elle est militairement et diplomatiquement intervenue au Yémen. Enfin, elle a coordonné l’action du Conseil de Coopération du Golfe pour réprimer les manifestations à Bahreïn qu’elle estimait téléguidées par l’Iran pour faire tomber la dynastie sunnite des Al Khalifa dans un pays majoritairement chiite.
Quant à Israël, son environnement stratégique a rarement été aussi préoccupant.
Quelque soit le prochain régime égyptien, il devra prendre ses distances d’avec Israël pour assoir sa légitimité politique intérieure.
En Syrie, les autorités de Tel-Aviv se satisfaisaient d’un dictateur immobile, sur le Golan notamment. L’idéal eut été pour la diplomatie israélienne le maintien d’un « Assad affaibli », c’est-à-dire contraint de casser son soutien au Hezbollah d’Hassan Nasrala au Liban.
Si l’on ajoute l’incertitude stratégique iranienne, on comprendra la sensibilité actuelle de la nouvelle donne sécuritaire pour Israël.

 Éditorialistes & Contributeurs
Éditorialistes & Contributeurs Corporate management
Corporate management