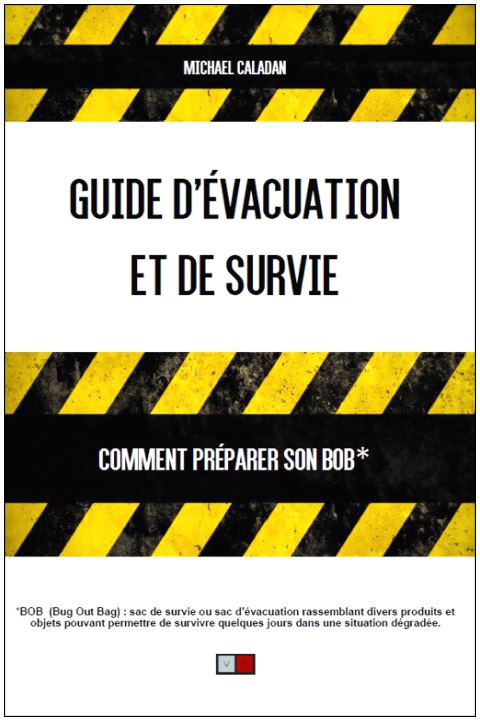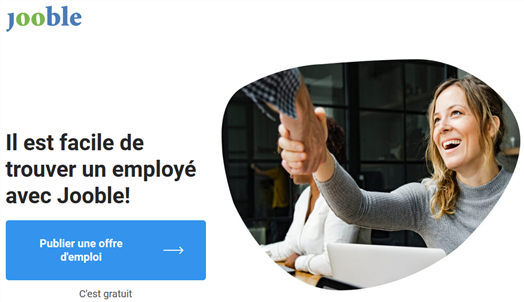freedigitalphotos/NixxPhotography
Une lecture superficielle de l’actualité stratégique porterait à croire que la puissance des Etats-Unis est sur la voie du déclin. L’enlisement en Afghanistan, la paralysie du processus de paix israélo-palestinien et l’engagement en arrière-plan en Libye derrière la France et le Royaume Uni semblent en attester. Sur le plan interne, la dette publique américaine dépasse le plafond autorisé, déjà élevé à la hauteur de 14 300 milliards de $ en 2010. Les divergences entre un président démocrate et une Chambre des représentants dominée par les Républicains paralysent cycliquement le vote du budget fédéral pendant plusieurs semaines. Cette perception est corroborée par l’opinion publique internationale : 72% des Français interrogés sont persuadés que la Chine a déjà ou va très probablement remplacer les Etats-Unis dans leur statut de superpuissance mondiale.
L’idée du repli américain est, en réalité, fort ancienne et l’on peut remonter aux thèses de Paul Kennedy qui, dès 1988, entrevoyait l’avenir d’une puissance accablée par ses engagements militaires, de moins en moins capable d’affecter ses ressources à l’innovation et à la croissance économique.
Il n’en demeure pas moins que les facteurs de crise semblent désormais très réels : faillite des grandes compagnies financières, Freddy Mac, Fanny Mae, Lehman Brothers, niveau d’endettement jamais atteint, déficit commercial récurrent et processus avéré de désindustrialisation au profit de la Chine.
Sur le plan diplomatique, l’administration Obama essuie, de surcroît, le feu des critiques conservatrices. Tandis que Sarah Palin déplore un engagement par trop prudent en Libye, d’autres comme Newt Gingrich s’élèvent contre sa réticence à envisager l’option militaire contre l’Iran. Le désengagement de l’Irak, tant décrié à ses débuts, l’est un peu moins chaque jour, un scénario à la vietnamienne n’ayant pas eu lieu.
S’il est vrai que, sur le plan économique, le champ des possibles reste ouvert, surtout en raison des inconnues liées à l’innovation technologique, mais aussi managériale, la diplomatie Obama semble mal comprise par les partisans de la Gunboat diplomacy.
Sur la scène internationale, les années écoulées de la présidence Obama avaient pour objectif de restaurer l’influence mondiale des Etats-Unis, discrédités vers la fin de la seconde présidence de G.W. Bush. Il n’est qu’à rappeler que l’unilatéralisme prôné par ce dernier a accéléré l’émergence de blocs politiques concurrents. Si l’approche multilatéraliste d’Obama n’a pas réussi à faire renaître la scène des années quatre-vingt-dix d’un multilatéralisme des grandes puissances sous hégémonie américaine, elle a, au moins, contribué à réduire le niveau de conflictualité dans les relations entre les Etats-Unis et les puissances eurasiatiques.
Quelques comparaisons s’imposent à cet égard :
- À l’issue de l’invasion de l’Irak, en avril 2003, l’administration Bush a réussi à dominer l’Europe en isolant la « vieille Europe » à l’aide de la « nouvelle », puis la France, en renforçant son partenariat avec l’Allemagne. À l’inverse, le désengagement relatif de l’administration Obama a suscité une demande d’Amérique au point que le Président américain s’est vu obligé de réitérer sa position en faveur du maintien des liens privilégiés avec le vieux continent.
- Alors même que le projet d’un « Grand Moyen-Orient démocratique » a été développé par les néo-conservateurs, ces derniers ont, par leurs pratiques sécuritaires et leur politique d’ « aggressive engagement », suscité l’hostilité des opinions publiques arabes et provoqué un effet repoussoir en lieu et place de l’effet domino initialement souhaité. C’est la combinaison de ce désengagement militaire et d’une diplomatie culturelle et non-officielle active qui ont été déterminants dans des pays arabes avec structures politiques vulnérables.
- De même, la prise de distance de l’Amérique Latine vis-à-vis des États-Unis est symptomatique. Le glissement à gauche des régimes politiques (à l’exception de la Colombie) et la diversification des partenaires économiques (la Chine étant devenue le premier partenaire du Brésil) y ont mis une fin à la doctrine du « back yard » célèbrement théorisée par James Monroe.
C’est pourquoi, l’ère Obama apparaît comme celle de la réhabilitation d’une diplomatie publique dont l’objectif est à la fois de recrédibiliser l’image des États-Unis et de la décliner aux multiples niveaux de la « soft power ». En tant qu’année électorale, 2012 a naturellement orienté la politique étrangère en direction de positions de compromis avec les Républicains et ménagé les groupes de pression internes capables d’influencer le cours de la campagne présidentielle.
Quant aux fondamentaux de la puissance américaine, il convient, pour avoir une vision objective de la capacité à rebondir de ce pays de rappeler qu’il demeure la première puissance monétaire, financière, bancaire et économique du monde ; le premier producteur d’énergie et le premier investisseur mondial.
Le budget de la défense américain reste égal aux 20 budgets militaires suivants.
Quant aux critères de la « soft power » préalablement évoquée, qu’il suffise de rappeler que 80 % des réseaux internet sont encore américains.
Autant d’atouts dont l’Europe est loin de disposer… surtout dans le contexte de crise actuel.
L’idée du repli américain est, en réalité, fort ancienne et l’on peut remonter aux thèses de Paul Kennedy qui, dès 1988, entrevoyait l’avenir d’une puissance accablée par ses engagements militaires, de moins en moins capable d’affecter ses ressources à l’innovation et à la croissance économique.
Il n’en demeure pas moins que les facteurs de crise semblent désormais très réels : faillite des grandes compagnies financières, Freddy Mac, Fanny Mae, Lehman Brothers, niveau d’endettement jamais atteint, déficit commercial récurrent et processus avéré de désindustrialisation au profit de la Chine.
Sur le plan diplomatique, l’administration Obama essuie, de surcroît, le feu des critiques conservatrices. Tandis que Sarah Palin déplore un engagement par trop prudent en Libye, d’autres comme Newt Gingrich s’élèvent contre sa réticence à envisager l’option militaire contre l’Iran. Le désengagement de l’Irak, tant décrié à ses débuts, l’est un peu moins chaque jour, un scénario à la vietnamienne n’ayant pas eu lieu.
S’il est vrai que, sur le plan économique, le champ des possibles reste ouvert, surtout en raison des inconnues liées à l’innovation technologique, mais aussi managériale, la diplomatie Obama semble mal comprise par les partisans de la Gunboat diplomacy.
Sur la scène internationale, les années écoulées de la présidence Obama avaient pour objectif de restaurer l’influence mondiale des Etats-Unis, discrédités vers la fin de la seconde présidence de G.W. Bush. Il n’est qu’à rappeler que l’unilatéralisme prôné par ce dernier a accéléré l’émergence de blocs politiques concurrents. Si l’approche multilatéraliste d’Obama n’a pas réussi à faire renaître la scène des années quatre-vingt-dix d’un multilatéralisme des grandes puissances sous hégémonie américaine, elle a, au moins, contribué à réduire le niveau de conflictualité dans les relations entre les Etats-Unis et les puissances eurasiatiques.
Quelques comparaisons s’imposent à cet égard :
- À l’issue de l’invasion de l’Irak, en avril 2003, l’administration Bush a réussi à dominer l’Europe en isolant la « vieille Europe » à l’aide de la « nouvelle », puis la France, en renforçant son partenariat avec l’Allemagne. À l’inverse, le désengagement relatif de l’administration Obama a suscité une demande d’Amérique au point que le Président américain s’est vu obligé de réitérer sa position en faveur du maintien des liens privilégiés avec le vieux continent.
- Alors même que le projet d’un « Grand Moyen-Orient démocratique » a été développé par les néo-conservateurs, ces derniers ont, par leurs pratiques sécuritaires et leur politique d’ « aggressive engagement », suscité l’hostilité des opinions publiques arabes et provoqué un effet repoussoir en lieu et place de l’effet domino initialement souhaité. C’est la combinaison de ce désengagement militaire et d’une diplomatie culturelle et non-officielle active qui ont été déterminants dans des pays arabes avec structures politiques vulnérables.
- De même, la prise de distance de l’Amérique Latine vis-à-vis des États-Unis est symptomatique. Le glissement à gauche des régimes politiques (à l’exception de la Colombie) et la diversification des partenaires économiques (la Chine étant devenue le premier partenaire du Brésil) y ont mis une fin à la doctrine du « back yard » célèbrement théorisée par James Monroe.
C’est pourquoi, l’ère Obama apparaît comme celle de la réhabilitation d’une diplomatie publique dont l’objectif est à la fois de recrédibiliser l’image des États-Unis et de la décliner aux multiples niveaux de la « soft power ». En tant qu’année électorale, 2012 a naturellement orienté la politique étrangère en direction de positions de compromis avec les Républicains et ménagé les groupes de pression internes capables d’influencer le cours de la campagne présidentielle.
Quant aux fondamentaux de la puissance américaine, il convient, pour avoir une vision objective de la capacité à rebondir de ce pays de rappeler qu’il demeure la première puissance monétaire, financière, bancaire et économique du monde ; le premier producteur d’énergie et le premier investisseur mondial.
Le budget de la défense américain reste égal aux 20 budgets militaires suivants.
Quant aux critères de la « soft power » préalablement évoquée, qu’il suffise de rappeler que 80 % des réseaux internet sont encore américains.
Autant d’atouts dont l’Europe est loin de disposer… surtout dans le contexte de crise actuel.

 Éditorialistes & Contributeurs
Éditorialistes & Contributeurs Corporate management
Corporate management