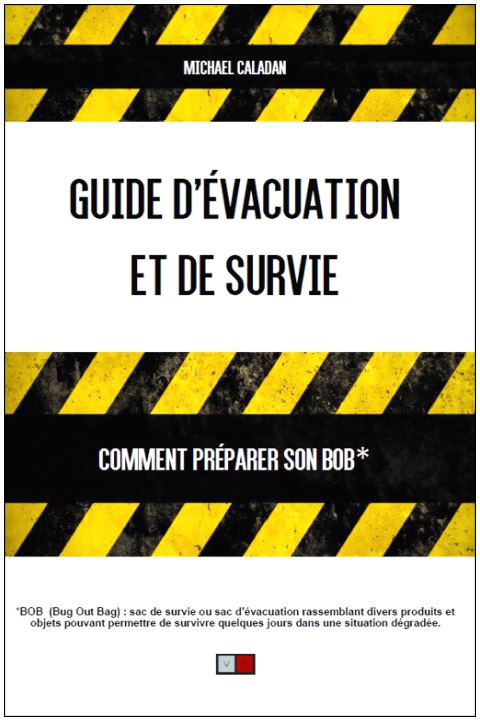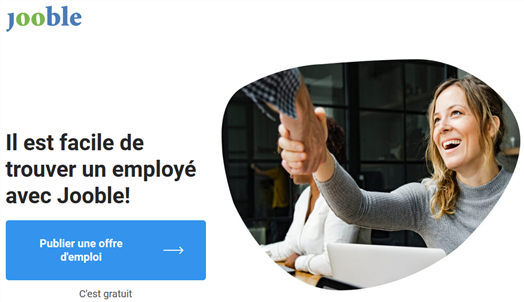Les indicateurs de confiance sont emblématiques de la capacité des entreprises à générer et à redistribuer de la richesse. Car en période d'incertitude, c'est l'aversion au risque qui remet en cause toute décision d'investissement.
Or, pire qu'un déficit de confiance dans l'économie, c'est aujourd'hui un sentiment de défiance à l'encontre de la rhétorique gouvernementale sur la notion de capital, qui se manifeste à travers les prises de position concertées d'entrepreneurs, qu'ils soient patrons de TPE ou dirigeants du CAC40. On pense bien sûr, dernièrement, à la lettre ouverte adressée au gouvernement par les patrons des cent plus grandes entreprises françaises.
D'autres sont moins médiatisées, comme celle de l'AFIC (1), l'association qui regroupe les principales structures de private equity françaises. Dans un communiqué récent, elle dénonçait l'absence de discernement, de la part du gouvernement, entre finance spéculative et investissement de long terme. Dans bien des cas, le capital investissement représente tôt ou tard la condition d'une transition réussie entre un projet d'entreprise et sa pérennisation.
Car on ne génère ni emploi, ni innovation sans capital. Il y a "finance" et "finance". Les dirigeants de start-up, de PME, ou d'ETI le savent mieux que quiconque. A plus forte raison lorsque leur entreprise rencontre une difficulté de trésorerie. Vouloir réserver au capital-investissement le même sort qu'au flash trading, par exemple, ce serait un peu comme jeter le bébé avec l'eau du bain.
Il faut être irrémédiablement endoctriné pour ne percevoir en nos entreprises et nos structures d'investissement que des machines à cash au profit de leurs fondateurs. Demandez-donc leur avis aux chefs d'entreprises qui renoncent à se verser un salaire, et qui ne vivent que de leurs dividendes, si tant est qu'il en reste après l'acquittement des cotisations et autres contributions diverses à l'effort fiscal. Demandez-donc leur avis aux business angels, qui investissent une partie de leur fortune personnelle pour mettre le pied de jeunes entrepreneurs à l'étrier, plutôt que de la mettre à l'abri rassurant d'une confortable rente immobilière.
Difficile d'admettre, dès lors, que la conjoncture est l'unique responsable de la morosité ambiante. La gouvernance "normale" se décline chaque jour davantage sous des airs de revanche idéologique galvanisée par l'aile la plus à gauche de l'hémicycle. Et à ce jeu, c'est le Premier ministre qui donne le La, en jouant sans encombre la partition de la lutte des classes. Lorsqu'il oppose, de façon à peine implicite, "le monde du travail" à "la vieille droite bourgeoise", c'est le pacte social qui devient fébrile, à l'heure précisément où c'est la cohésion de tout un écosystème - entrepreneurs, investisseurs et salariés - qu'il serait urgent de restaurer. Aujourd'hui la France est profondément divisée. Entre les indifférents, les résignés, et les résistants. Et c'est l'individualisme, ce versant naturel d'un climat de méfiance généralisé, qui reprend du galon.
De façon plus prosaïque, posons-nous ces questions essentielles au bon fonctionnement d'une économie: le message adressé aux marchés par le gouvernement est-il vraiment propice à encourager les entrepreneurs à investir dans le capital humain ou la R&D, principaux fondements la compétitivité hors-prix? Ou au contraire, règne-t-il un climat délétère en France, au point d'affecter les conditions d'une reprise durable?
Pour ce qui est de l'ambiance, c'est plutôt mal parti. Les préconisations du rapport Gallois sont encore commentées par l'exécutif avec une certaine condescendance, et les atermoiements des ministres autour d'une hypothétique politique industrielle digne de ce nom deviennent anxiogènes pour tout le monde.
On a beau essayer de nous dresser le portrait d'un Président manifestement combatif et déterminé, rien n'y fait. Il manque encore un capitaine à la barre, un cap politique dans la tempête. Si l'on s'en tient aux déclarations d'intention, on y perçoit un écueil éloquent: la crise actuelle se résumerait à une crise des finances publiques, à laquelle on remédie par des ponctions supplémentaires. Mais lorsqu'il n'y aura plus d'entreprises, il n'y aura plus ni ponctions... ni dépenses publiques. Aucune piste tangible n'est évoquée pour restaurer le niveau de compétitivité de nos entreprises ou consolider l'attractivité du territoire. Pis, on assiste à l'émergence d'un cas d'obésité morbide frappant un goinfre budgétaire incapable de se réformer.
Faute de pragmatisme, il manque une volonté politique autour de notre avenir économique, gagé sur l'autel de l'électoralisme. Avachi dans son excès d'optimisme (ou d'insouciance?) il y a encore quelques mois, notre pays découvre avec stupeur qu'il est sur le point de basculer de l'autre côté de l'Europe, celle du sud, et qu'il n'est plus tout à fait ce qu'il convient d'appeler un leader européen. Au mieux, c'est un wagon arrimé par un fil à la locomotive allemande.
Pendant ce temps, le débat politique s'est cristallisé autour du sort que l'on réservera aux "riches" (qu'avec un minimum de bon sens on appellera les "détenteurs de capitaux"), sans s'inquiéter de l'exode potentiel des fonds d'investissement, des business angels ou des holdings familiales. Donc de la disparition des start-up, des gazelles ou de toute autre forme de "velléité" entrepreneuriale susceptible de générer de l'emploi pérenne, aussi modeste soit-elle.
Bientôt les citoyens, à défaut d'espérer pouvoir un jour se hisser au statut de "riche", auront fini par le haïr. C'est à ce moment précis qu'il faudra renoncer à se plaindre du fait que notre terroir, nos industries et nos marques sont rachetées par des fonds souverains étrangers, faute d'une alternative hexagonale viable. Et à ce moment-là, peut-être que la France sera devenue la vitrine poussiéreuse d'un prestige et d'une opulence révolus. Un avenir ô combien enthousiasmant pour les générations futures qui n'auront plus alors, pour seule perspective de réussite, que celle d'un exil.
Si l'on en juge l'histoire économique de la France, elle est un pays profondément colbertiste, et cela lui réussit plutôt bien. En témoigne la longue histoire de notre industrie, depuis les Manufactures du Roi jusqu'à la construction d'un réseau de télécommunications parmi les plus numérisés au monde. La question n'est donc pas de savoir s'il y a trop d'Etat, mais plutôt quelle est la posture que l'Etat doit adopter vis-à-vis de l'entrepreneuriat et du capitalisme. Le vrai problème français, sous-jacent, c'est celui de notre rapport aux élites économiques.
Par-delà de la crise financière, ne devrait-on pas s'évertuer à solder, d'abord, une profonde crise des valeurs? Pourquoi cette France qui adule le regretté Steve Jobs (autant qu'elle plébiscite, certes dans une moindre mesure, le rafraîchissant Richard Branson), déteste-t-elle autant ses propres entrepreneurs?
Cela signifie peut-être qu'elle adhère encore au rêve américain, mais que le rêve français s'apparente pour elle à une chasse au dahu. Le rôle du politique, c'est aussi de créer du rêve pour l'avenir. En France, on ne manque pourtant pas de marchands de sable.
Mais au contraire, en donnant chair à la vindicte à travers ses éléments de discours mal rodés, le gouvernement risque de faire vaciller tout l'édifice hexagonal de création de richesses. Mais il aura réussi un coup de maître en nous faisant occulter que le premier confiscateur de richesses n'est pas "le riche" ou l'entrepreneur, mais bel et bien l'Etat dont les dépenses annuelles s'élèvent à 55% du PIB.
Dans un tel contexte, le problème est grave: cela signifie que ce sont les institutions censées coordonner et soutenir la vie économique qui sont devenues défaillantes. Auquel cas nous ne sommes plus face à un problème conjoncturel, mais bel et bien structurel: l'Etat français n'est plus le catalyseur de ces ambitions économiques qui ont permis au pays de financer jusqu'alors son modèle social, aussi cher soit-il.
La France a besoin de ses entrepreneurs. Être entrepreneur n'est pas une position confortable. Entreprendre induit des risques, des responsabilités et des sacrifices. Traitons, au moins, nos entrepreneurs avec un peu plus de tact.
(1) Association Française des Investisseurs pour la Croissance
Or, pire qu'un déficit de confiance dans l'économie, c'est aujourd'hui un sentiment de défiance à l'encontre de la rhétorique gouvernementale sur la notion de capital, qui se manifeste à travers les prises de position concertées d'entrepreneurs, qu'ils soient patrons de TPE ou dirigeants du CAC40. On pense bien sûr, dernièrement, à la lettre ouverte adressée au gouvernement par les patrons des cent plus grandes entreprises françaises.
D'autres sont moins médiatisées, comme celle de l'AFIC (1), l'association qui regroupe les principales structures de private equity françaises. Dans un communiqué récent, elle dénonçait l'absence de discernement, de la part du gouvernement, entre finance spéculative et investissement de long terme. Dans bien des cas, le capital investissement représente tôt ou tard la condition d'une transition réussie entre un projet d'entreprise et sa pérennisation.
Car on ne génère ni emploi, ni innovation sans capital. Il y a "finance" et "finance". Les dirigeants de start-up, de PME, ou d'ETI le savent mieux que quiconque. A plus forte raison lorsque leur entreprise rencontre une difficulté de trésorerie. Vouloir réserver au capital-investissement le même sort qu'au flash trading, par exemple, ce serait un peu comme jeter le bébé avec l'eau du bain.
Il faut être irrémédiablement endoctriné pour ne percevoir en nos entreprises et nos structures d'investissement que des machines à cash au profit de leurs fondateurs. Demandez-donc leur avis aux chefs d'entreprises qui renoncent à se verser un salaire, et qui ne vivent que de leurs dividendes, si tant est qu'il en reste après l'acquittement des cotisations et autres contributions diverses à l'effort fiscal. Demandez-donc leur avis aux business angels, qui investissent une partie de leur fortune personnelle pour mettre le pied de jeunes entrepreneurs à l'étrier, plutôt que de la mettre à l'abri rassurant d'une confortable rente immobilière.
Difficile d'admettre, dès lors, que la conjoncture est l'unique responsable de la morosité ambiante. La gouvernance "normale" se décline chaque jour davantage sous des airs de revanche idéologique galvanisée par l'aile la plus à gauche de l'hémicycle. Et à ce jeu, c'est le Premier ministre qui donne le La, en jouant sans encombre la partition de la lutte des classes. Lorsqu'il oppose, de façon à peine implicite, "le monde du travail" à "la vieille droite bourgeoise", c'est le pacte social qui devient fébrile, à l'heure précisément où c'est la cohésion de tout un écosystème - entrepreneurs, investisseurs et salariés - qu'il serait urgent de restaurer. Aujourd'hui la France est profondément divisée. Entre les indifférents, les résignés, et les résistants. Et c'est l'individualisme, ce versant naturel d'un climat de méfiance généralisé, qui reprend du galon.
De façon plus prosaïque, posons-nous ces questions essentielles au bon fonctionnement d'une économie: le message adressé aux marchés par le gouvernement est-il vraiment propice à encourager les entrepreneurs à investir dans le capital humain ou la R&D, principaux fondements la compétitivité hors-prix? Ou au contraire, règne-t-il un climat délétère en France, au point d'affecter les conditions d'une reprise durable?
Pour ce qui est de l'ambiance, c'est plutôt mal parti. Les préconisations du rapport Gallois sont encore commentées par l'exécutif avec une certaine condescendance, et les atermoiements des ministres autour d'une hypothétique politique industrielle digne de ce nom deviennent anxiogènes pour tout le monde.
On a beau essayer de nous dresser le portrait d'un Président manifestement combatif et déterminé, rien n'y fait. Il manque encore un capitaine à la barre, un cap politique dans la tempête. Si l'on s'en tient aux déclarations d'intention, on y perçoit un écueil éloquent: la crise actuelle se résumerait à une crise des finances publiques, à laquelle on remédie par des ponctions supplémentaires. Mais lorsqu'il n'y aura plus d'entreprises, il n'y aura plus ni ponctions... ni dépenses publiques. Aucune piste tangible n'est évoquée pour restaurer le niveau de compétitivité de nos entreprises ou consolider l'attractivité du territoire. Pis, on assiste à l'émergence d'un cas d'obésité morbide frappant un goinfre budgétaire incapable de se réformer.
Faute de pragmatisme, il manque une volonté politique autour de notre avenir économique, gagé sur l'autel de l'électoralisme. Avachi dans son excès d'optimisme (ou d'insouciance?) il y a encore quelques mois, notre pays découvre avec stupeur qu'il est sur le point de basculer de l'autre côté de l'Europe, celle du sud, et qu'il n'est plus tout à fait ce qu'il convient d'appeler un leader européen. Au mieux, c'est un wagon arrimé par un fil à la locomotive allemande.
Pendant ce temps, le débat politique s'est cristallisé autour du sort que l'on réservera aux "riches" (qu'avec un minimum de bon sens on appellera les "détenteurs de capitaux"), sans s'inquiéter de l'exode potentiel des fonds d'investissement, des business angels ou des holdings familiales. Donc de la disparition des start-up, des gazelles ou de toute autre forme de "velléité" entrepreneuriale susceptible de générer de l'emploi pérenne, aussi modeste soit-elle.
Bientôt les citoyens, à défaut d'espérer pouvoir un jour se hisser au statut de "riche", auront fini par le haïr. C'est à ce moment précis qu'il faudra renoncer à se plaindre du fait que notre terroir, nos industries et nos marques sont rachetées par des fonds souverains étrangers, faute d'une alternative hexagonale viable. Et à ce moment-là, peut-être que la France sera devenue la vitrine poussiéreuse d'un prestige et d'une opulence révolus. Un avenir ô combien enthousiasmant pour les générations futures qui n'auront plus alors, pour seule perspective de réussite, que celle d'un exil.
Si l'on en juge l'histoire économique de la France, elle est un pays profondément colbertiste, et cela lui réussit plutôt bien. En témoigne la longue histoire de notre industrie, depuis les Manufactures du Roi jusqu'à la construction d'un réseau de télécommunications parmi les plus numérisés au monde. La question n'est donc pas de savoir s'il y a trop d'Etat, mais plutôt quelle est la posture que l'Etat doit adopter vis-à-vis de l'entrepreneuriat et du capitalisme. Le vrai problème français, sous-jacent, c'est celui de notre rapport aux élites économiques.
Par-delà de la crise financière, ne devrait-on pas s'évertuer à solder, d'abord, une profonde crise des valeurs? Pourquoi cette France qui adule le regretté Steve Jobs (autant qu'elle plébiscite, certes dans une moindre mesure, le rafraîchissant Richard Branson), déteste-t-elle autant ses propres entrepreneurs?
Cela signifie peut-être qu'elle adhère encore au rêve américain, mais que le rêve français s'apparente pour elle à une chasse au dahu. Le rôle du politique, c'est aussi de créer du rêve pour l'avenir. En France, on ne manque pourtant pas de marchands de sable.
Mais au contraire, en donnant chair à la vindicte à travers ses éléments de discours mal rodés, le gouvernement risque de faire vaciller tout l'édifice hexagonal de création de richesses. Mais il aura réussi un coup de maître en nous faisant occulter que le premier confiscateur de richesses n'est pas "le riche" ou l'entrepreneur, mais bel et bien l'Etat dont les dépenses annuelles s'élèvent à 55% du PIB.
Dans un tel contexte, le problème est grave: cela signifie que ce sont les institutions censées coordonner et soutenir la vie économique qui sont devenues défaillantes. Auquel cas nous ne sommes plus face à un problème conjoncturel, mais bel et bien structurel: l'Etat français n'est plus le catalyseur de ces ambitions économiques qui ont permis au pays de financer jusqu'alors son modèle social, aussi cher soit-il.
La France a besoin de ses entrepreneurs. Être entrepreneur n'est pas une position confortable. Entreprendre induit des risques, des responsabilités et des sacrifices. Traitons, au moins, nos entrepreneurs avec un peu plus de tact.
(1) Association Française des Investisseurs pour la Croissance

 Éditorialistes & Contributeurs
Éditorialistes & Contributeurs Corporate management
Corporate management